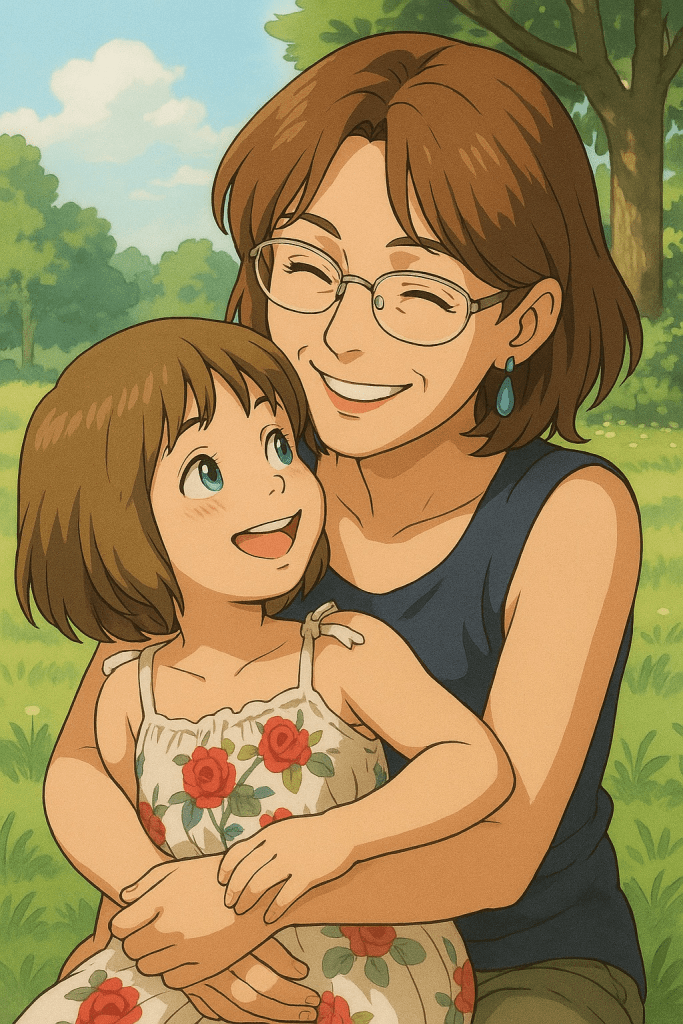Néa avait décidé de me blesser.
Elle avait choisi son père. Elle avait choisi Berlin.
Elle avait choisi de vivre loin de moi.
Et quand elle est partie, elle m’a à peine regardée.
Le trop d’amour, la déception, transformés en colère, puis en haine.
Une haine silencieuse, glacée, qui disait : “Tu m’as déçue, alors je t’efface.”
Mais moi, je l’aimais.
Et elle souffrait. Elle souffrait tellement qu’elle a commencé à se blesser.
Petites coupures. Partout.
Des cris muets sur la peau.
Mais personne n’écoutait. Ni son père. Ni sa compagne.
Alors elle m’a appelée.
Elle m’a dit : “Je me fais du mal.”
Je n’ai pas hésité :
“Rentre à la maison. Je suis là. Je vais t’aider, mon amour.”
Elle est revenue en France. C’était en 2022.
Et là, l’enfer a commencé.
Elle était instable. Elle ne supportait plus l’école. Elle voulait toute mon attention.
Mais ce n’était pas sa faute. Ce n’était la faute de personne.
On était juste deux âmes fatiguées, épuisées par une douleur trop grande pour nous. Et c’était moi, l’adulte, qui n’arrivais plus à tenir.
Je ne pouvais pas me dédoubler.
J’étais seule. Trois cœurs à porter : Bruno, son grand frère, Linda, sa petite sœur, et elle.
Et chacun voulait être le seul.
Je faisais de mon mieux.
Mais c’était mon pire.
Je l’ai accompagnée à chaque rendez-vous au RéseDa.
Psychologues, psychiatres, éducateurs.
Mais la douleur ne passait pas.
Elle voulait exister autrement.
Alors elle a avalé mes comprimés. Mon alprazolam.
Tentative de suicide. Premier internement.
Long. Douloureux.
Mais on parlait chaque soir.
Elle me parlait de son père, de sa peur.
Elle disait qu’elle s’était sentie violée. Pas physiquement, mais psychiquement.
Assez pour se sentir brisée.
Assez pour se couper.
Et pourtant, elle s’ouvrait. Elle se faisait des amis.
Je lui apportais à manger, des écouteurs, des livres, tout ce qu’elle demandait.
Je prenais le bus. Je marchais. Quarante kilomètres pour un sourire.
Elle allait mieux.
On était proches, complices.
Puis elle est sortie.
Mais ce n’était pas fini.
Deuxième hospitalisation. Plus longue.
Ils l’ont laissée sortir en disant que tout allait bien.
Qu’elle continuerait les soins à la maison.
Et c’est là qu’elle a voulu partir.
Vacances à Palerme. Chez son grand-père. Une semaine.
J’ai accepté, à condition qu’elle parte avec Bruno et Linda.
Les médecins étaient d’accord.
“Ça lui fera du bien.”
Je me suis assurée que tout serait sous contrôle.
J’ai dit à mon père : “Cache les médicaments. Enlève les couteaux. Sois vigilant.”
Mais il n’a rien fait.
Il a décidé que tout était de notre faute, à moi et à mon ex-mari.
Il a décidé qu’il serait meilleur parent.
Alors il l’a gardée.
Et là, j’ai su que j’avais perdu le contrôle.
Peut-être que j’aurais dû prendre le premier vol, venir la chercher, l’arracher à ce piège.
Peut-être que tout aurait été différent.
Mais ce n’est pas ce que j’ai fait.
Et c’est là que la machine a commencé à nous broyer.