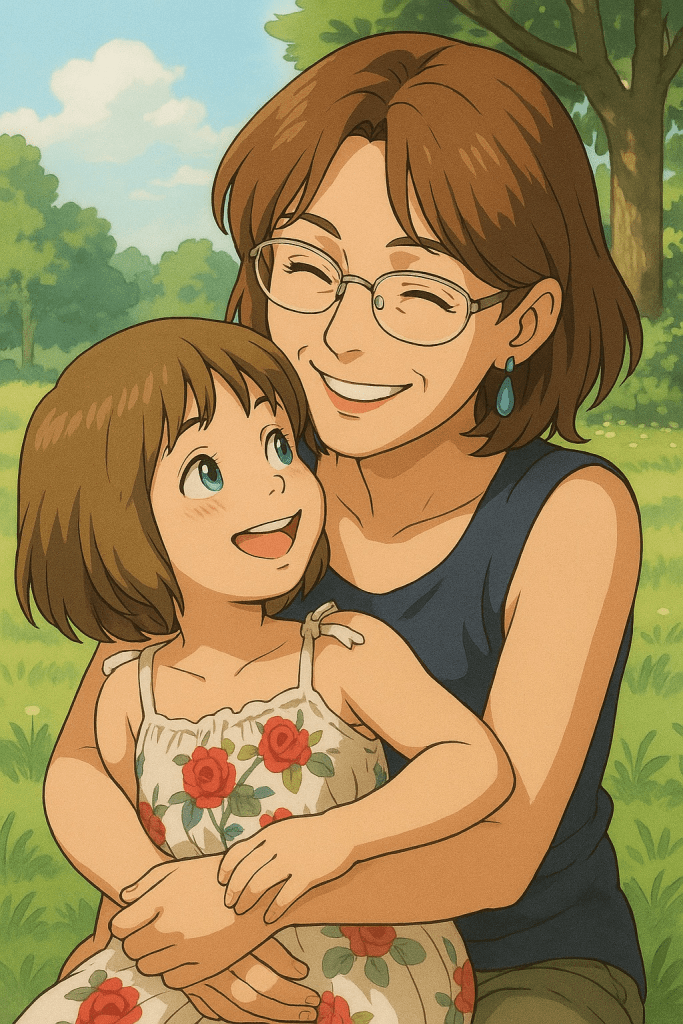Quand on nous a dit qu’on pouvait retourner à la chambre d’hôtes pour récupérer nos affaires, j’ai cru que c’était une récompense.
Comme si, pour une raison obscure, on nous concédait une pause dans un jeu cruel dont personne ne semblait connaître les règles.
On avait peu de temps : ils nous attendaient avant 19 heures, comme si la nuit pouvait nous exclure pour toujours.
J’ai couru entre les draps défaits, les sacs à moitié pleins d’une vie encore normale, pour récupérer des vêtements, des dessins, un livre, un nounours, la brosse pleine de cheveux de Linda.
Je ne me rappelle plus ce que j’ai laissé.
Je sais juste que je courais avec une faim au ventre, une urgence qui n’était pas que dans l’horloge, mais dans le besoin de redevenir, même une heure, celle que j’étais avant.
À notre retour, cette parenthèse s’est refermée comme une barrière métallique claquée d’un coup sec.
Nos affaires – ces choses, les nôtres – se sont répandues dans l’entrée du foyer comme une explosion domestique : sacs de courses débordants, plastique tendu à craquer, chaussettes qui dépassaient des poignées comme des fleurs froissées.
Pas de valises, seulement des sacs et de la précipitation.
Et là, au milieu de cette montagne improvisée, une voix féminine – Claudia, je crois – a lâché avec un mélange de surprise et d’agacement :
« Mais c’est quoi tout ce bordel que vous avez ? »
Minchia.
Un mot qui rebondit dans l’air palermitain comme une mouche, qui revient toujours, se pose sur tout.
Et que, sans m’en rendre compte, j’allais adopter moi aussi.
Ma putain sicilienne personnelle.
Un drapeau planté sur le balcon de cette nouvelle réalité.
Le soir, ce fut le vrai plongeon en enfer.
La salle à manger n’avait qu’une seule table, longue, centrale, pensée pour réunir tout le monde, mais qui semblait conçue pour séparer plus que pour unir.
Elle était trop haute pour moi.
Alors on nous installa à part, sur une petite table basse, une table d’école primaire, placée dans un coin, presque par hasard.
Moi, Bruno et Linda étions là, immobiles, les jambes tordues, les mains posées, retenant notre souffle.
Manger était impossible.
On avait peur que le moindre geste nous fasse remarquer.
Autour, quatorze personnes se hurlaient dessus, lançaient des piques, des ricanements acérés, des insultes, dans un sabir que je comprenais à moitié mais qui me blessait entièrement.
Une cacophonie continue, un théâtre instable où les voix étaient des couteaux et chaque repas un champ de bataille.
Et cet endroit — ce n’était pas juste laid.
C’était infâme.
Pas à cause de ceux qui y vivaient – chacun traînait son enfer –
mais à cause de la façon dont on nous avait jetés là,
nous trois,
comme trois chats abandonnés sur l’autoroute.
Sans abri.
Et sans personne pour ralentir.
Et pourtant, le lendemain matin, j’eus un de ces élans qu’on ne connaît que sur le bord du précipice.
Je me levai tôt de mon lit–berceau – un vieux canapé à ressorts qui m’avait chanté des berceuses de rouille toute la nuit – et j’allai dans la cuisine.
Elle était vide.
Silencieuse.
Sacrée.
J’avais récupéré un peu de tout : pain, lait, biscottes, confiture, café soluble, beurre, quelques œufs.
J’ai mis la cafetière sur le feu et j’ai commencé à préparer le petit-déjeuner avec l’enthousiasme d’une déléguée de classe en sortie scolaire.
Peut-être que je voulais croire que c’était ça, justement : une excursion.
Une anomalie douce avant le retour à la normale.
La table se remplissait : assiettes, tasses, serviettes chipées dans un tiroir oublié.
J’avais un sourire à deux cents dents, celui de quelqu’un qui ne sait plus où il est mais qui a décidé de faire de cette demi-heure une fête.
Puis, derrière moi, une voix plate, sans yeux ni bouche, m’a simplement dit :
« La nourriture ne se gaspille pas. »
Un reproche, ou peut-être juste un rappel administratif.
Je ne sais pas.
Mais je l’ai pris au sérieux.
Je me suis assise.
Et je n’ai plus jamais cuisiné.
Et je n’ai plus jamais préparé un vrai petit-déjeuner comme celui-là. Jamais.
C’est aussi ce jour-là que je l’ai remarqué :
un mouchoir en papier collé sur le frigo avec du scotch.
Dessus, les jours de la semaine, et les prénoms des femmes du foyer.
Juste en dessous, un autre bout de papier froissé, avec les noms des garçons.
Le premier, c’étaient les tours de ménage – cuisine, salle de bain, salon.
Le second, ceux qui devaient mettre la table.
J’ai pensé :
« Waouh, c’est chouette ! Ce sont eux qui font les tâches ! »
Jamais je n’aurais imaginé que
mon nom y serait inscrit aussi.